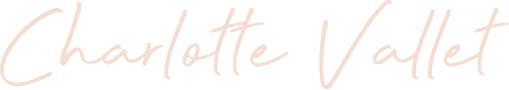Pourquoi l’abandon nous concerne tous
Depuis neuf ans, j’accompagne des femmes, des adultes, parfois des enfants devenus grands, dans leurs parcours de vie et leurs relations. Et une vérité s’impose avec constance : la blessure de l’abandon traverse nos histoires, qu’elle soit vécue de manière brutale ou insidieuse.
Elle s’exprime dans l’angoisse qui surgit dès qu’un lien menace de se rompre,
dans la peur qu’un attachement trop fort se transforme en dépendance,
dans la difficulté à avoir confiance en soi ou à préserver une image de soi stable,
et dans ces situations où une personne qui en souffre se débat avec des émotions trop profondes pour être ignorées.
La psychologie parle de syndrome abandonnique. Mais derrière les termes techniques, il y a une expérience vécue : celle d’un enfant qui n’a pas eu la sécurité affective dont il avait besoin, et d’un adulte qui rejoue ensuite ce schéma dans ses relations, parfois jusqu’à développer une relation fusionnelle marquée par l’angoisse de séparation.
Cette blessure est liée à l’enfance, mais elle ne disparaît pas avec l’âge adulte. Elle influence le rapport à soi, la capacité à aimer, à faire confiance, à reconnaître sa propre valeur. Elle alimente des conflits intérieurs, des réactions disproportionnées, et parfois même un trouble de la personnalité.
Pourtant, il existe toujours une solution : libérer de la peur, travailler sa conscience, transformer ses liens.
C’est un processus profond, difficile parfois, mais qui aide réellement à sortir du sentiment d’insécurité et à retrouver l’équilibre.
Abandon précoce : une cause profonde aux conséquences durables
Un enfant qui vit une séparation à un jeune âge, qui ressent un manque de présence affective ou une absence prolongée, développe un schéma relationnel insécure.
Les symptômes sont connus :
- angoisse de séparation,
- sentiment d’insécurité,
- faible estime de soi,
- comportements fusionnels ou jaloux,
- dépendance affective vis-à-vis du partenaire.
Ces difficultés ne disparaissent pas avec le temps : elles marquent la personne souffrant d’abandon tout au long de son existence, jusque dans sa relation amoureuse, sa famille, son activité professionnelle.
C’est un cercle vicieux : plus on tente de contrôler pour ne pas être quitté, plus on provoque la rupture redoutée.
Le syndrome abandonnique : quand la peur devient un mode de vie
Les psychologues parlent de syndrome abandonnique.
Une personne abandonnique vit dans une tension constante :
- peur de la solitude,
- besoin d’attention disproportionné,
- jalousie vis-à-vis du partenaire,
- comportements de contrôle,
- incapacité à développer un sentiment de sécurité affective.
Le rapport à soi et aux autres devient une prison relationnelle :
- dans le couple, l’amour se confond avec la dépendance,
- dans l’amitié, la loyauté remplace la liberté,
- dans la société, la peur de perdre sa place bloque l’épanouissement.
L’abandon se caractérise alors par une angoisse persistante qui menace l’équilibre émotionnel et la santé mentale.
Une société qui fabrique de l’abandon
L’abandon n’est pas seulement une blessure intime : il est produit par nos structures sociales.
- Dans les familles : les parents reproduisent inconsciemment ce qu’ils ont vécu.
- À l’école : certains enfants restent invisibles, réduits à des notes, privés de reconnaissance.
- Dans le travail : la menace permanente de l’échec ou du rejet alimente l’angoisse collective.
- Dans le monde : chaque jour, des milliers de personnes sont réellement abandonnées sans soutien.
L’impact est massif : anxiété généralisée, troubles relationnels, développement de schémas insécures, reproduction générationnelle du même manque de confiance.
L’abandon est donc une réalité relationnelle, psychologique et politique.
Le rôle du couple et des relations amoureuses
Dans la relation amoureuse, la blessure d’abandon s’exprime avec force.
- peur constante d’être quitté·e,
- besoin de fusion,
- jalousie excessive,
- recherche compulsive de preuves d’amour.
Ces comportements détruisent progressivement la sécurité affective du couple.
La relation devient une lutte pour retenir plutôt qu’un espace de liberté.
Reconnaître ces signes est essentiel pour éviter que l’amour ne soit remplacé par la peur.
Santé mentale et thérapie : des clés pour guérir
La blessure de l’abandon n’est pas une fatalité.
Les approches thérapeutiques permettent de soigner la peur et de retrouver un équilibre.
Le coaching
Je peux vous accompagner à comprendre vos comportements, vos schémas psychologiques et vos insécurités relationnelles, afin d’identifier l’origine de la peur d’abandon et de reconnaître l’endroit où se situe réellement votre potentiel. Car bien souvent, la crainte de l’abandon naît d’un manque de confiance en soi et d’une tendance à se sous-estimer. Pour en savoir plus sur ces sujets, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter.
L’hypnose
L’hypnose permet d’aller dialoguer avec l’inconscient, là où s’est inscrite l’origine de cette peur. Elle aide à apaiser l’angoisse, à transformer les schémas relationnels et à recréer en soi un sentiment de sécurité affective.
Le soutien relationnel
La guérison passe aussi par la présence de proches bienveillants, capables d’offrir un espace de vérité et d’écoute.
Accepter l’abandon : la clé paradoxale
On croit guérir en serrant les liens de toutes ses forces. Mais c’est l’inverse.
- Tant qu’on cherche à retenir, on nourrit la peur.
- La vraie guérison passe par un lâcher-prise radical : accepter que l’autre puisse partir.
Je le sais parce que je l’ai vécu.
Petite, j’ai connu l’absence de mes parents. Puis la DASS. Ce vide m’a façonnée. Longtemps, j’ai cru que l’abandon était une condamnation.
Mais au fil des années, j’ai découvert une vérité : ce qui me terrifiait le plus — être quittée, perdre, voir partir ceux que j’aimais — ne me tuait pas.
Au contraire. Chaque rupture, chaque départ m’a renforcée.
C’est en osant regarder cette peur en face, en laissant l’autre partir, que j’ai cessé de me sentir prisonnière.
J’ai compris que ma valeur ne dépendait pas d’une présence extérieure.
« Même si tu pars, je demeure. Même si je perds, je me retrouve. »
Voilà comment, pas à pas, j’ai guéri cette blessure.
Et c’est cela que je transmets aujourd’hui : la possibilité de se libérer de la peur en cessant de lutter contre elle.
Une blessure intime, relationnelle et politique
- La blessure de l’abandon n’est pas seulement psychologique : elle est aussi sociale et politique.
- Elle révèle nos défaillances collectives et appelle une transformation.
- Pour l’individu, c’est un appel à guérir.
Pour les familles, une invitation à reconnaître leurs transmissions invisibles.
Pour la société, la nécessité de créer une culture de la sécurité affective et du soutien.
FAQ – Comprendre et dépasser l’abandon
Quels sont les symptômes du syndrome abandonnique ?
Une angoisse constante, la peur d’être quitté, une dépendance émotionnelle, une jalousie forte, un sentiment d’insécurité permanent.
Quelles sont les causes de la peur d’abandon ?
Parent absent, séparation précoce, manque de sécurité affective, traumatisme relationnel.
Comment surmonter cette peur ?
En travaillant sur soi, je peux vous aider sur le sujet.
Quel est l’impact de cette blessure dans le couple ?
Elle entraîne des comportements fusionnels, jaloux ou contrôlants, qui finissent par nuire à la relation amoureuse.
La blessure d’abandon est-elle seulement intime ?
Non. Elle est aussi sociale et politique : nos structures fabriquent du rejet et entretiennent des schémas d’insécurité.
Conclusion : transformer la peur en liberté
La blessure de l’abandon est une expérience intime, une conséquence sociale et une menace collective.
Mais elle peut devenir une source de libération.
- Identifier ses schémas.
- Apprendre à gérer ses réactions.
- Développer une sécurité affective intérieure.
- Accepter de laisser partir ce qui ne sonne pas juste.
Alors, l’abandon ne reste pas une plaie ouverte, mais devient une source thérapeutique, relationnelle et politique.
La vérité libère. L’amour reconstruit.